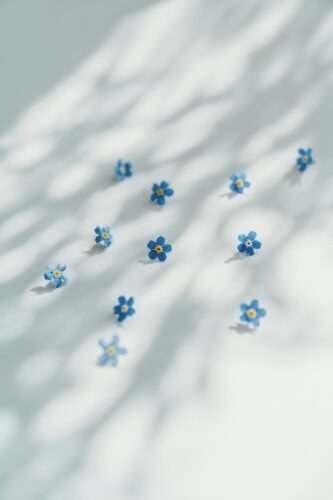 Je me demande ce qui, tout ce temps, m’a poussée à venir te voir.
Je me demande ce qui, tout ce temps, m’a poussée à venir te voir.
Il y a longtemps, tu m’aurais dit que c’était normal de rendre visite à sa mère.
Oui mais voilà, il y a longtemps que tu n’es plus ma mère, du moins que tu ne joues plus ton rôle de mère. Mais à 40 ans passés, ai-je encore besoin que tu t’occupes de moi comme quand j’avais 2 mois, 4 ans, ou 9, ou 17, ou 25 ?
Non, évidemment. Quoique… Y a-t-il un âge limite pour ne pas se sentir abandonnée ?
Toujours est-il que ce temps-là est révolu, la faute à Alzheimer et à ses ravages impitoyables, adieu implacable à toute dignité. Pendant un temps, c’était moi la mère, toi la petite fille capricieuse qui ne voulait en faire qu’à sa tête, une tête de moins en moins valide. Une inversion des rôles dont je ne voulais pas, que j’ai repoussée de toutes mes forces, mais avec laquelle il a bien fallu composer.
T’abandonner dans la meilleure maison de repos spécialisée à une heure de chez moi, une culpabilité lourde à digérer.
Est-ce pour cela que je venais te voir chaque semaine ? Pour m’assurer qu’on te traitait bien, que tu t’adaptais, ou que tu ne m’en voulais pas, que tu m’aimais toujours ? Mais tu n’en avais déjà plus la capacité. Tu ne me reconnaissais plus depuis ce jour où tu m’avais montré une photo de moi à trois ans en me disant : « tu vois cette petite fille ? C’est Sylvie », et où je te répondais : « ah oui, c’est moi il y a longtemps ». Et toi : « non non, ce n’est pas toi, c’est ma fille ».
Est-ce que je venais te voir parce que j’en avais envie ? Non.
Parce que je m’y sentais obligée ? Sans doute. Qu’auraient pensé le reste de la famille, l’équipe soignante, si je ne venais plus ? « quelle fille indigne, celle-là ».
Et puis j’ai espacé mes visites, malgré la culpabilité, malgré ce que je croyais qu’on penserait de moi.
Je tentais de me justifier à mes propres yeux en me disant que de toute façon il n’était plus possible de communiquer avec toi, que tu ne te rendais plus compte de ma présence, que ça ne t’apportait rien.
La vérité, c’est que c’est à moi que ces visites n’apportaient plus rien. Une demi-heure à te regarder assise dans ton lit agitant les mains et gazouillant comme un bébé, sans me voir. Trente minutes à espérer un contact visuel, un vrai regard, un regard comme avant, une ou deux secondes pendant lesquelles tu m’aurais reconnue, où tu te serais rappelée. Bête espoir.
Tu avais l’air heureuse dans ton monde, ça aussi je me le disais pour me rassurer, mais c’était peut-être vrai. Je crois que tu étais la seule à ne pas souffrir de ta situation. Drôle de consolation.
Pendant ces visites j’aurais pu te parler de ce que je faisais, de ce que je ressentais, de mon travail, de mon nouvel appartement, de mes amis, de mes passe-temps.
Je n’y suis jamais arrivée. Je n’ai jamais su quoi dire pendant ces trente minutes qui s’écoulaient goutte à goutte. Je ne suis plus jamais arrivée à te dire « maman ».
Ce que je ressentais, je l’ai écrit par-ci par-là, une façon de rester à distance raisonnable, supportable, et de ne pas me donner en spectacle devant toi. Ridicule, cette pudeur, sans doute.
Le lundi 17 mars au matin, quand on m’a téléphoné à 9h32 pour me dire que je devais venir, que c’était une question d’heures, d’un jour ou deux au plus, j’ai sauté dans ma voiture et avalé les kilomètres jusqu’à ta chambre. Ta respiration encombrée, sifflante, heurtée, cela faisait mal à entendre. On me disait que la morphine t’empêchait de souffrir mais c’était difficile à croire. Respirer était un effort, le dernier que tu arrivais tout juste à faire.
Je suis restée là à te regarder, une heure, deux, peut-être trois. Je n’ai pas eu le courage de passer la nuit à côté de toi. Je n’avais plus cette force, je me sentais tellement inutile.
Le 18 mars à 19h27, mon téléphone a sonné. En voyant le numéro s’afficher sur l’écran, j’ai compris. L’aide-soignante m’a dit, des larmes dans sa voix chevrotante : « Votre maman est partie, je suis désolée. Je l’ai accompagnée jusqu’au dernier moment ». Après un échange de quelques phrases de remerciement, de compassion et de dispositions pratiques, j’ai raccroché, sans comprendre ce que je ressentais.
Pas une larme, la froideur d’un bloc de glace, la dureté d’une paroi de coffre-fort.
Je cherche encore la faille, la fissure d’où sortira enfin une émotion, quelle qu’elle soit.
Peut-être s’écoulera-t-elle dans l’encre de ce stylo.



